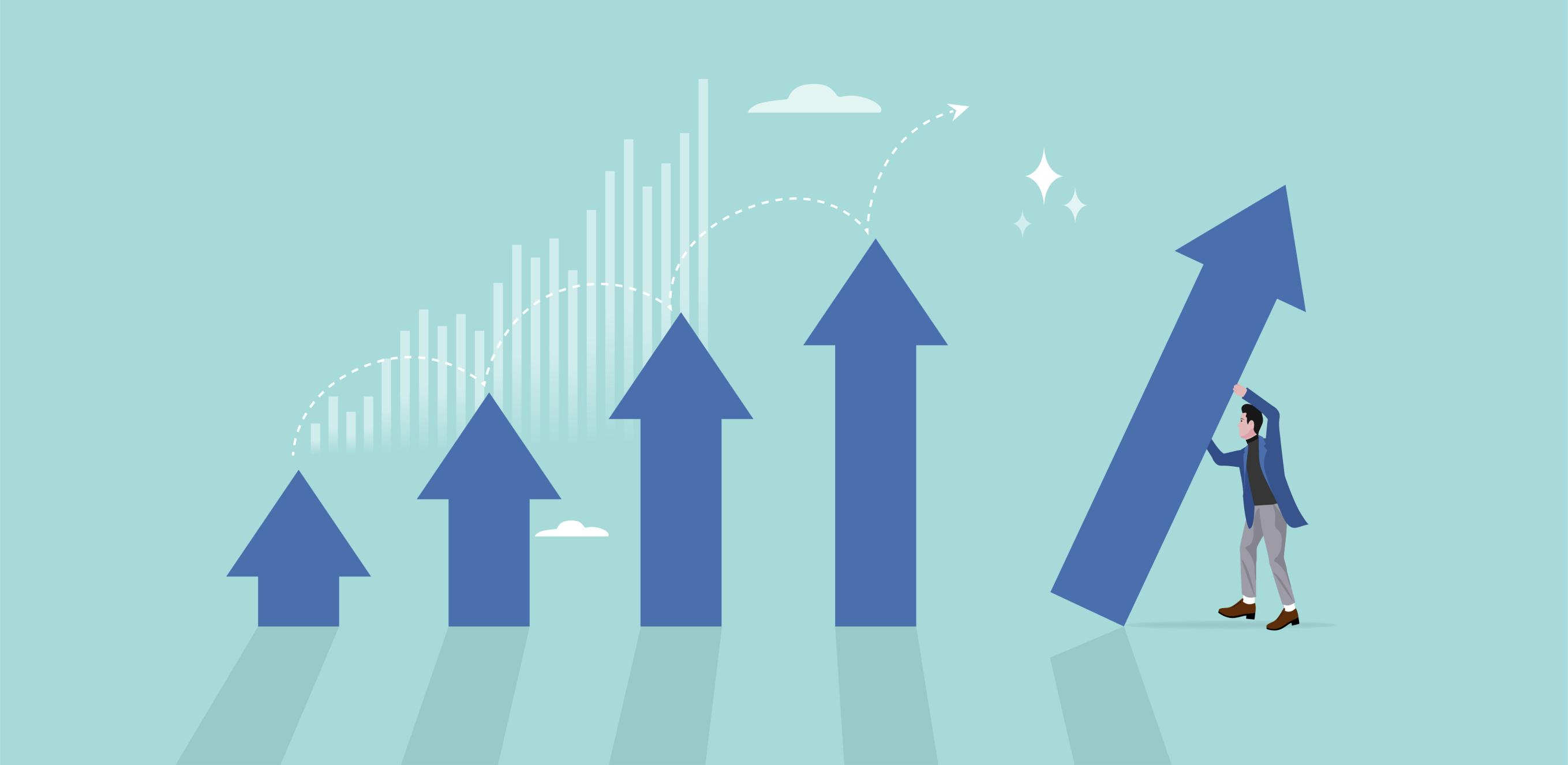© Hyvia - Avec ses quatre réservoirs hydrogène et sa pile à combustible dans le sur-toit, cette version du Renault Master Van H2 par Hyvia affiche une autonomie de 500 km pour un remplissage en 3 à 5 minutes.
© Hyvia - Avec ses quatre réservoirs hydrogène et sa pile à combustible dans le sur-toit, cette version du Renault Master Van H2 par Hyvia affiche une autonomie de 500 km pour un remplissage en 3 à 5 minutes. Avec ses quatre réservoirs hydrogène et sa pile à combustible dans le sur-toit, cette version du Renault Master Van H2 par Hyvia affiche une autonomie de 500 km pour un remplissage en 3 à 5 minutes. l' é à
Selon Santé publique, la France dénombre chaque année près de 40 000 décès prématurés attribuables aux particules fines (PM10 et PM2,5). Cette pollution atmosphérique, émise par la circulation automobile et le chauffage, est aussi responsable de la dégradation de la fonction pulmonaire, des maladies cardiovasculaires, cancers, etc. Par ailleurs, 7 0...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous