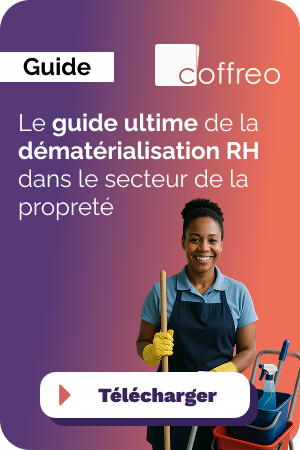Le nettoyage de préservation et de sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers après un incendie peut présenter divers risques (électrique, manutention manuelle, chute de plain-pied, coupure, chimique, …). Lors d’un incendie, il y a combustion de matériaux. Cette combustion est à l’origine d’émanations de fumées qui vont se disperser pour partie...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous