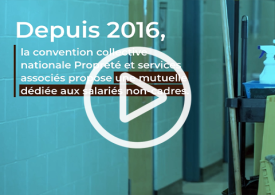Bien que l’usage de l’amiante ait été interdit à partir du 1er janvier 1997, il existe encore aujourd’hui de nombreux bâtiments publics et privés dans lesquels les sols sont recouverts de dalles vinyle amiante (DVA). Sans être exhaustif, on peut citer les immeubles de logements collectifs, les bâtiments tertiaires, les établissements scolaires et u...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous